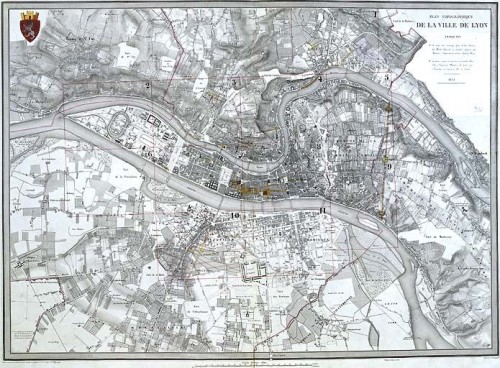Prunelle
 C’est une petite rue de quelques trente mètres, sur ce qu’on appelle ici « les pentes ». Elle débouche sur la place Rouville et l’une des plus belles vues de Lyon. Au cœur du quartier des tisseurs, par décision du conseil municipal en date du 9 mars 1843, elle honore un homme qui pourtant ne fut pas très tendre avec les canuts du XIXème. Gabriel Prunelle fut l’une des ces grandes figures médicales dont s’enorgueillit la bourgeoisie lyonnaise au XXème siècle. Né le 23 juin 1777, à la Tour du Pin, il partit étudier la médecin à Montpellier où il passa sa thèse en 1800 et se lia d’amitié avec le chimiste Jean-Antoine Chaptal. Il fut nommé bibliothécaire de l’école de médecine de cette ville et profita de ce poste pour effectuer maints détournements dans diverses bibliothèques publiques de France. Ces rapines indélicates eurent beau être dénoncées, il fut nommé professeur de Médecine Légale de la Faculté de Montpellier, lors de sa création en 1807.
C’est une petite rue de quelques trente mètres, sur ce qu’on appelle ici « les pentes ». Elle débouche sur la place Rouville et l’une des plus belles vues de Lyon. Au cœur du quartier des tisseurs, par décision du conseil municipal en date du 9 mars 1843, elle honore un homme qui pourtant ne fut pas très tendre avec les canuts du XIXème. Gabriel Prunelle fut l’une des ces grandes figures médicales dont s’enorgueillit la bourgeoisie lyonnaise au XXème siècle. Né le 23 juin 1777, à la Tour du Pin, il partit étudier la médecin à Montpellier où il passa sa thèse en 1800 et se lia d’amitié avec le chimiste Jean-Antoine Chaptal. Il fut nommé bibliothécaire de l’école de médecine de cette ville et profita de ce poste pour effectuer maints détournements dans diverses bibliothèques publiques de France. Ces rapines indélicates eurent beau être dénoncées, il fut nommé professeur de Médecine Légale de la Faculté de Montpellier, lors de sa création en 1807.
Il se maria à une riche lyonnaise, fille de soyeux, et s’établit en 1821 dans la capitale des Gaules, où il exerça la médecine quelques années avant de s’intéresser à la politique. Son engagement auprès des libéraux en fit un opposant à la Restauration et le cofondateur du journal le Précurseur. C’est lui qui présida le banquet de cinq cents couverts offert par des loges maçonniques au vieux général de la Fayette, le 6 septembre 1829. Il est connu pour avoir commis auprès de Mme de Chateaubriand qui l’avait consulté lors d’un de ses passages à Lyon une grossière erreur de diagnostic.
Prunelle devint maire de la ville en 1830, tous les autres candidats s’étant récusés. Cette même année le vit élu député de l’Isère. Il mérita grâce à ce siège quelques mots de Stendhal qui le traita de « député vendu ». Durant son mandat de cinq ans, deux émeutes éclatèrent dans sa ville (1831 et 1834). Lors des événements de novembre 1831, le maire Prunelle brilla par son absence, dont il fit habilement un argument politique contre le préfet Bouvier Dumolard : lorsqu’il fallut rendre des comptes, il rédigea pour Casimir Perrier un rapport sévère sur la carence des autorités militaires et préfectorales. Nommé médecin inspecteur des eaux de Vichy en 1833, il brilla à nouveau par son absence durant les révoltes de 1834 et les mutuellistes lyonnais qui dénoncèrent sa « haine des travailleurs » et son « mépris du peuple », obtinrent sa démission le 8 mai 1835. Habilement, Prunelle finit sa carrière maire de Vichy.
Il meurt le 20 août 1850, après une journée passée en compagnie d’Adolphe Thiers. A Vichy aussi, une rue lui fut consacrée, celle-là même où se trouve l’Hôtel du parc où résida Pétain.
Lyon lui doit l’organisation de l’école La Martinière, fondée grâce à l’héritage du major Martin. Il fit aussi restaurer le Palais Saint-Pierre et ouvrir le quai de la Pêcherie. C’est enfin lui qui ordonna les tous premiers essais d’éclairage au gaz dans quelques rues et obtint le partiel rétablissement des Facultés des sciences et des Lettres, lesquelles avaient été supprimées pendant la Restauration.
Daumier, qui le caricatura sur la demande de Charles Philipon comme tous les notables du « juste milieu » l’avait surnommé monsieur Prune. Au musée d’Orsay, on peut admirer aujourd’hui son buste parmi les 36 réalisés entre 1832 et 1836 par le dessinateur du journal La Caricature.

 noires murailles entourées de bosquets, des tours bizarrement dessinées formaient, avec la forteresse de l’autre côté de la rivière, une masse imposante de fortifications qui se reflétaient dans la Saône. C’est là que, durant huit jours, les prisonniers se préparèrent, par la prière, à une mort qu’ils attendaient avec résignation »
noires murailles entourées de bosquets, des tours bizarrement dessinées formaient, avec la forteresse de l’autre côté de la rivière, une masse imposante de fortifications qui se reflétaient dans la Saône. C’est là que, durant huit jours, les prisonniers se préparèrent, par la prière, à une mort qu’ils attendaient avec résignation »