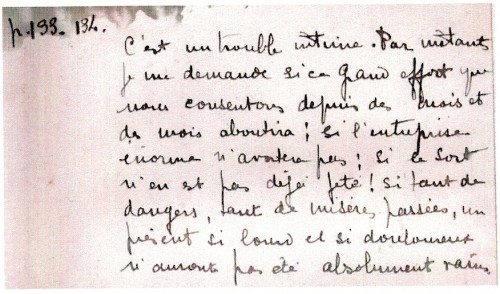« Quand j’entendis cet admirable cri de douleur et de mélancolie (Le chant des ouvriers, 1846), je fus ébloui et attendri. Il y avait tant d’années que nous attendions un peu de poésie forte et vraie (…) Il est impossible, à quelque parti qu’on appartienne, de quelques préjugés qu’on ait été nourri, de ne pas être touché du spectacle de cette multitude maladive respirant la poussière des ateliers, avalant du coton, s’imprégnant de céruse, de mercure et de tous les poisons nécessaires à la création des chefs-d’œuvre, dormant dans la vermine, au fond des quartiers où les vertus les plus humbles et les plus grandes nichent à côté des vices les plus endurcis …» C’est Baudelaire qui écrivit ceci, dans l’un des deux articles qu’il consacre au lyonnais Pierre Dupont sans sa Critique Littéraire.
La rue Pierre Dupont, dans le 1er arrondissement de Lyon, est parallèle au boulevard de la Croix-Rousse, du cours du général Giraud à la rue des Chartreux. Avant d’être dédiée au poète chansonnier du dix-neuvième siècle, l’un de ses tronçons portait le nom du Cardinal Fesch, oncle de Napoléon Ier qui fut archevêque de Lyon, l’autre le nom de « clos des Chartreux », en raison du domaine qui jouxtait la rue.
Pierre Dupont vécut cinquante ans, de 1821 à 1871. Il avait perdu sa mère à quatre ans. Son père, forgeron, fut tué pendant l’insurrection lyonnaise de 1831. Son parrain, qui était prêtre, prêtre fit parachever son éducation au séminaire de Largentière. Au sortir de la maison religieuse, Dupont entra dans la canuserie, où il fut apprenti. Puis il devint employé de banque et, grâce au soutien d’un académicien, obtint un poste à la rédaction du Dictionnaire. Il commença à écrire très jeune, une œuvre qui se décompose en trois : des chants rustiques, des chants ouvriers, et quelques poèmes philosophiques ; l’écriture de Dupont, pour paraphraser Baudelaire, est hantée par deux secrets, qui sont les clés de sa fortune d'alors, et celles aussi de l'oubli dans lequel il est tombé à présent : « la joie et le goût infini de la République ».
On raconte qu’encore jeune, Pierre Dupont se rendit place Royale pour rencontrer Victor Hugo. Comme ce dernier était absent, il lui laissa sa carte sur laquelle il crayonna les vers suivants :
« Si tu voyais une anémone
Languissante et près de périr,
Te demander, comme une aumône,
Une goutte d’eau pour fleurir ;
Si tu voyais une hirondelle
Un jour d’hiver te supplier,
A ta vitre battre de l’aile,
Demander place à ton foyer,
L’hirondelle aurait sa retraite,
L’anémone sa goutte d’eau !
Pour toi, que ne suis-je, ô Poète,
Ou l’humble fleur ou l’humble oiseau. «
Gounod lui trouvait une voix remarquable et s’étonna qu’il ne connût rien à la musique. A quoi Dupont répondit qu’il était heureux de n’y rien connaître, et qu’il ne tenait pas à l’apprendre. Une date, dans sa vie, a été un moment charnière : celle de février 1848, dont son Chant des Ouvriers devint l’hymne. Il mourut l’année même de la consécration définitive de cette dernière, après avoir, de 1848 à 1870 traversé le règne de Napoléon III en ardent républicain. A cause de ses aspirations socialistes, il avait été condamné pour sept années à la déportation après le coup d’Etat de 1851 et avait dû sa grâce à quelques puissants admirateurs, ainsi qu’à l’allégeance qu’on le força de prononcer envers le nouveau régime. Pour toute sa génération, Pierre Dupont, fut, digne successeur de Bérenger, le talentueux chansonnier du petit peuple, le chantre militant de la République. Jusqu’à la guerre de 14, et au gigantesque fossé d’oubli qu’elle creusa entre un avant et un après, une romance à la Dupont, c’est ce qui accompagnait les hommes, des fêtes données pour leur baptême, à celles données lors de leur enterrement, en passant par les banquets de mariage. Dupont laissa la réputation d’un solide bon vivant, qui buvait comme un héros antique. « Les vieux de Vaise, relate Louis Maynard dans son Dictionnaire des Lyonnaiseries, ont longtemps conservé le souvenir de beuveries qui duraient plusieurs jours et plusieurs nuits. » Béraud, dans sa Gerbe d’Or, rappelle avec verve la façon dont son père boulanger, républicain passionné, ténorisait du Dupont au pétrin, dans une page de son récit d'enfance que traverse, de part en part, la gaieté.

On a, depuis, oublié Pierre Dupont et sa philosophie simple. En voici quelques couplets :
Rêve, paysan, rêve :
Entends la semence qui lève,
Regarde tes bourgeons rougir,
Et comme tes enfants grandir :
C’est l’avenir !
(Le Rêve du paysan)
Aimons-nous, et quand nous pouvons
Nous unir pour boire à la ronde,
Que le canon se taise ou gronde,
Buvons, buvons, buvons,
A l’indépendance du monde !
(Le chant des ouvriers)
Alerte, imprimeurs !
Inondez de lueurs
Le monde qui tâtonne ;
Faut-il que le flambeau
Reste sous le boisseau ?
Non, il faut qu’il rayonne !
( L’imprimerie)
Gouttes d’eau, filles du nuage,
Filtrez à travers le feuillage
Sur l’étang attiédi,
Car ma mie au gentil corsage,
Aux pieds blancs, au rose visage,
Y vient sur le midi.
( Midi )
Des deux pieds battant mon métier,
Je tisse, et ma navette passe,
Elle siffle, passe et repasse,
Et je crois entendre crier
Une hirondelle dans l’espace.
( Le Tisserand)
Aux armes, courons aux frontières,
Qu'on mette au bout de nos fusils
Les oppresseurs de tous pays
Les poitrines des Radetskis !
Les peuples sont pour nous des frères,
Et les tyrans, des ennemis.
( Le chant des Soldats)
Le 20 octobre 2010 à 20h 30, au cinéma Saint-Denis (grande rue de la Croix-Rousse), Jean Butin et Gérard Truchet donneront une conférence en chansons sur la vie trop oublié de ce chansonnier.